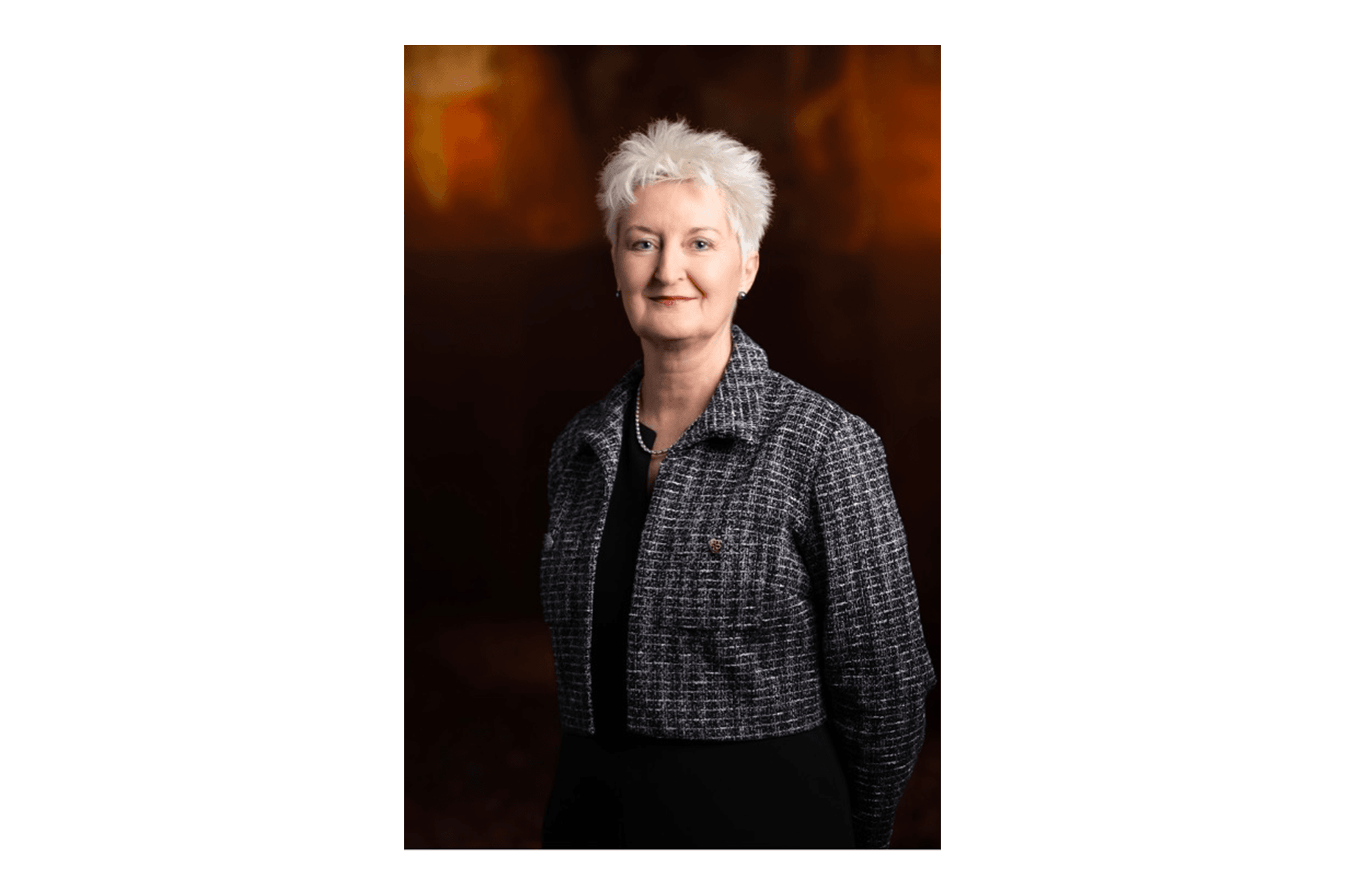CIÉCO est fier de s’associer au Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) pour la tenue d’une conférence de la commissaire Isabelle Bertolotti. Cette grande conférence sur le commissariat d’exposition s’inscrit dans le cadre du Partenariat Des nouveaux usages des collections dans les musées d’art et d’une série d’initiatives et de réflexions menées par l’équipe de la conservation du MAC en vue de la réouverture du musée dans ses espaces de la rue Sainte-Catherine, à la suite de son grand projet de transformation.
La conférence d’Isabelle Bertolotti aura lieu dans l’Auditorium de la Grande Bibliothèque de BAnQ, le lundi 23 mars, à 18 h.
Isabelle Bertolotti
Historienne d’art, formée à l’Université Lyon 2 et à l’École du Louvre, Isabelle Bertolotti est directrice artistique de la Biennale de Lyon depuis 2019 et directrice du macLYON depuis 2018, après en avoir dirigé le service des expositions depuis 1995. Elle est la cofondatrice et codirectrice artistique, depuis 2002, de la manifestation Rendez-vous, jeune création internationale, événement consacré à la scène émergente française et internationale récemment intégré à la Biennale de Lyon. Elle a organisé l’exportation de la manifestation sur différentes scènes extra-européennes : Shanghai en 2008 et 2010, Le Cap en 2012, Singapour en 2015, Pékin en 2017 et La Havane en 2018.
Isabelle Bertolotti est également commissaire indépendante spécialiste de la scène émergente internationale. Elle est membre de l’Association des biennales internationales (IBA), qui rassemble des directrices et directeurs de biennales du monde entier et mène une réflexion sur les nouvelles pratiques de ces grands événements.
Crédit photo : Lionel Rault
Partenaires
Musée d’art contemporain de Montréal (MAC)
Partenaire
Actualités connexes
Lancement de l’ouvrage _L’essor des contre-muséologies_

Lancement de l’ouvrage L’essor des contre-muséologies
- En ligne
- Montréal
L’essor des contre-muséologies, une publication codirigée par Sarah Turcotte, Anna-Lou Galassini et Jean-Marie Lafortune, est l’aboutissement d’un projet de réflexion et de collaboration au long cours, qui s’inscrit dans la continuité de plusieurs initiatives, notamment un colloque présenté au 91e congrès de l’Acfas et un numéro publié en partenariat avec la Fédération Histoire Québec. Il témoigne d’un engagement durable autour des enjeux sociaux, critiques et participatifs en muséologie, et propose des perspectives renouvelées à partir de l’idée des contre-muséologies et de leurs pratiques.
Exposition au Musée d’art de Joliette : _la clarté creuse les montagnes_

Exposition au Musée d’art de Joliette : la clarté creuse les montagnes
- Joliette
- Musée d’art de Joliette
la clarté creuse les montagnes, commissariée par Ariane De Blois, réunit les artistes asinnajaq, Stina Baudin, Nathalie Batraville, Amanda Boulos, Berirouche Feddal, Shannon Garden-Smith, Frantz Patrick Henry et Tyson Houseman.
Webinaire « Musées d’art en plein air / Sculpture Parks »

Webinaire « Musées d’art en plein air / Sculpture Parks »
- En ligne
Le webinaire « Musées d’art en plein air / Sculpture Parks » consiste à donner la parole à des spécialistes et à des professionnels du monde de l’art sur la question de la muséalisation de l’art public.
Cycle de conférences « À propos d’exposition » à la Galerie UQO

Cycle de conférences « À propos d’exposition » à la Galerie UQO
- Galerie UQO (GUQO)
- Gatineau
Dans le cadre du programme court de troisième cycle en théories et pratiques de l’exposition mis sur pied conjointement par la Galerie UQO et l’École des arts et cultures (Édac), la directrice et commissaire Marie-Hélène Leblanc aura à sa charge le cours EXP6033 – Rencontres avec les spécialistes cet hiver.